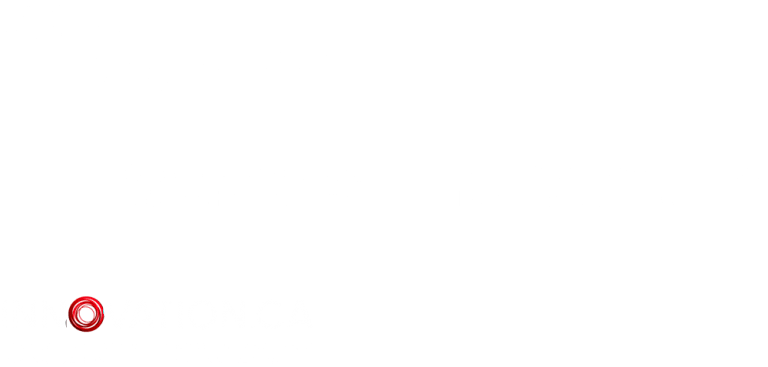L’histoire du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (le CRIMT) est marquée par trois grandes périodes de développement.
< 2002
Au cours des années 1990, une dizaine de spécialistes du travail et de l’emploi collaborent à divers projets, dont plusieurs portent sur l’évolution de la régulation du travail à l’ère de la mondialisation. Ces collaborations se distinguent à plusieurs égards : elles sont interdisciplinaire et multifacultaires ; elles mobilisent divers courants théoriques et traditions de recherche empirique ; elles réunissent des chercheur.euses provenant de plusieurs universités au Québec (Université de Laval, Université de Montréal et HEC Montréal, notamment) ; elles sont tournées vers l’international et comptent plusieurs collaborateur.trices à l’étranger. Plusieurs des projets autour desquels s’articulent ces collaborations trouvent appuis auprès des Conseils de recherche du Québec et du Canada. Finalement, au début des années 2000, ces chercheur.euses recevront un premier financement structurant dans le cadre du programme de Soutien aux équipes de recherche du Fonds FCAR.
L’un des aspects remarquables de cet histoire : bon nombre des chercheur.euses de cette période sont toujours actif.ives au sein du Centre. Le lancement – en 2021 – des bourses Jacques-Bélanger et Pierre-Verge permettra de souligner le travail pionnier de ces chercheurs qui, malheureusement, nous ont quitté prématurément.
2003-2016
La création du CRIMT en tant que centre de recherche répond à deux impulsions principales. Tout d’abord, il est le fruit d’un effort visant à concevoir un programme de recherche interdisciplinaire sur l’évolution du travail à l’ère de la mondialisation. Ensuite, cet effort coïncide avec le lancement de nouvelles initiatives de financement par les Conseils de recherche du Québec et du Canada, qui visent à soutenir ce type de projets. À la suite de concours exigeants, le CRIMT obtient un premier financement en tant que centre en démarrage du programme des Regroupements stratégiques du Fonds de recherche du Québec – Société et culture. Par la suite, il reçoit un financement pour un premier projet de recherche d’envergure dans le cadre du programme des Grands travaux de recherches concertées (GTRC) du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Cela marque le début de la deuxième période.
Le CRIMT se transforme en un lieu dynamique de collaborations interdisciplinaires et interuniversitaires sur le travail et l’emploi à l’ère de la mondialisation. Le regroupement compte alors une trentaine de chercheur.euses au Québec et sensiblement le même nombre hors des frontières de la province. En outre, il cherche à développer une architecture scientifique ouverte qui permette – par la diversité de ses activités – d’entretenir des collaborations au-delà des frontières du regroupement.
La mise en place du centre est rapide et suivie d’une phase de consolidation qui s’étend jusqu’à la fin des années 2000, où le CRIMT obtient un renouvellement de son financement à titre de Regroupement stratégique (jusqu’en 2016), cette fois en tant que centre en fonctionnement. Preuve de la solidité des assises qu’il a créées, l’équipe reçoit un deuxième financement en 2008 dans le cadre du programme des GTRC du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, ce qui renouvelle le financement de sa programmation de recherche jusqu’en 2016.
Durant cette période, le Centre est extrêmement actif dans le domaine scientifique et de la formation. Le CRIMT organise de nombreuses activités d’animation scientifique, y compris une dizaine de grands colloques internationaux. Bien avant l’engouement actuel pour les sites de partage vidéo, le Centre met à disposition des centaines d’enregistrements vidéo utiles pour la formation et la diffusion des connaissances. De plus, ses chercheur.euses éditent près de trente numéros spéciaux de revues scientifiques et publient des centaines d’articles, ce qui permet d’accélérer le transfert des résultats du projet et d’accroître sa visibilité. En outre, plus de trente doctorant.es et postdoctorant.es formé.es au sein du CRIMT accèdent à la carrière universitaire entre 2003 et 2016, contribuant ainsi au renouvellement d’une partie importante du corps professoral en droit du travail et en relations industrielles au Québec.
2017 >
Ce site reflète la période la plus récente de l’histoire du Centre, qui a débuté au printemps 2017 et se poursuit jusqu’à nos jours. Cette période est marquée par l’expansion du CRIMT et l’internationalisation accrue de ses activités. Grâce au renouvellement de son financement en tant que Regroupement stratégique (jusqu’en 2024), le CRIMT établit les bases d’un projet ambitieux visant à créer un partenariat de recherche international axé sur l’étude de l’expérimentation institutionnelle et son potentiel d’amélioration du travail. En 2017, le CRIMT a reçu un financement du Programme de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et s’est associé à un réseau international de centres partenaires pour mieux comprendre les conditions qui sous-tendent l’innovation sociale et sont susceptibles de conduire à une amélioration du travail. Ce projet d’importance implique 184 cochercheur.euses, dont 52 au Québec, 16 au Canada et 116 dans une douzaine d’autres pays.
Le projet accorde une attention particulière aux acteurs qui s’engagent dans l’expérimentation sociale (tant organisationnelle qu’institutionnelle) et aux ressources de pouvoir qui leur permettent d’en infléchir le cours. À travers l’analyse de cas d’expérimentation et de leur réexamen itératif afin d’en affiner la compréhension, le projet fournit des résultats permettant d’appréhender le changement et de mieux comprendre comment les acteurs répondent, par l’innovation, aux enjeux qu’il suscite. Ce site présente les grandes lignes du projet, de même que les activités scientifiques et les publications qui en découlent.